
Un peu d’histoire
C’est un peu intime, de raconter son histoire, mais je crois de plus en plus que le privé est politique, et qu’on ne permet jamais mieux à autrui de comprendre les problèmes sociaux qu’en les exprimant en termes de vécus. Les statistiques c’est important aussi, mais les comptes ne servent à rien… si on ne sait pas ce qu’on compte.
On va parler de succès, d’ascenseur social, de mérite, de réussite, de classes sociales, mais aussi de patriarcat, et de racisme.
On va partir d’un peu loin, de mes origines rurales, catholiques, populaires. Mes grands-parents maternels étaient prolétaires. Ma grand-mère « bonne à tout faire », d’après sa carte d’identité, mon grand-père employé communal, il faisait les jardins et l’entretien des trottoirs. Mes grands-parents paternels étaient clairement plus aisés, ils étaient exploitants agricoles, et ça tournait pas mal. Mes parents sont des boomers. Quand ils se sont mariés, ils ont commencé pauvres, ma mère était à l’usine à 14 ans, mais il y avait du travail. Ma mère travaillait d’arrache-pied et gagnait sa vie, ce qui faisait « tourner la maison » et cela a permis à mon père de monter sa boîte… avec un petit coup de pouce au départ, de mes grands-parents paternels, pour s’équiper. Il a mis quelques années, avant que ça ne marche, mais à force de persistance, ça a marché.
Mes parents sont devenus assez aisés, et je suis née à une époque faste de leur vie. Grace à cela, j’ai pu, à cause de mes difficultés scolaires (j’étais cancre, bonne dernière), être placée dans un établissement privé à petits effectifs au collège. J’ai été suivie, cadrée. A un moment j’ai eu un déclic, je me suis mise au travail, très fort. J’avais des résultats irréguliers, mais dans certaines matières, ça payait, alors j’ai persévéré. Dans ma famille, on n’était pas très cultivés, mais moi j’avais un attrait pour les sciences. Alors je me suis abonnée à Sciences et Vie, et j’ai petit à petit rattrapé le niveau dans la plupart des matières, jusqu’à passer un bac S, que j’ai eu avec une mention assez bien. A ma grande déception. J’aurais pu avoir une mention bien, vu mes notes, mais le passif de cancre m’a rattrapée : avec le manque de confiance en moi et le stress, j’ai échoué dans certaines épreuves. Après le bac S, je suis allée à la fac. Mes parents avaient les moyens de me payer mes études, et j’ai donc pu étudier sans trop me soucier de mes finances. Je bossais l’été, car quand même on a culture familiale où il faut se prendre en main, mais en réalité, ça me faisait juste de l’argent de poche. J’ai réussi brillamment, j’ai eu facilement une bourse de doctorat, j’ai fait une thèse. Bref : je suis le pur exemple d’un ascenseur social qui fonctionne… a priori.
Pourquoi alors, suis-je devenue anticapitaliste ? Comment ? A cause de l’autre moitié de ma vie. Au moment de la thèse, à la fac, j’ai rencontré le futur père de mes enfants, venu étudier en France. Il était originaire d’un pays Africain, musulman. Il avait passé pas mal d’années en France déjà, et culturellement, je me sentais plus proche de lui que de mes parents, parce qu’on fréquentait la fac tous les deux. Il avait deux diplômes de master, il avait étudié. Pas mes parents. Il était moderne, il faisait la cuisine et le ménage alors que mon père avait toujours été dans son canapé avec le journal, et les autres hommes (blancs) que je connaissais étaient pas très « faisants » non plus. Certains des mecs blancs instruits que j’ai croisés à la fac étaient lourdement sexistes, faisant des blagues sur le fait que des femmes qui font des maths ne sont pas des vraies femmes, ou lourdement racistes, citant des études pétées suggérant que certaines races auraient des QI inférieurs. Ils étaient tellement lourds. Lui non. Il était extrêmement respectueux de mes limites corporelles. Il était respectueux de mes ambitions. Quand je l’ai rencontré, il était sur le point de partir, pour rentrer chez lui et valoriser ses diplômes, mais il a attendu, car je faisais ma thèse. Il était travailleur et ambitieux, et il savait qu’il n’avait aucune chance de valoriser ses diplômes en France, qu’il serait réduit au cumul de petits boulots, comme ceux qu’il a fait pendant ma thèse : la plonge, la mise en rayon, les déménagements. Alors il m’a dit : j’attends que tu finisses, mais mon choix, c’est de rentrer. Donc quand tu auras fini, je rentre. J’ai dis ok.
J’adorais la recherche, mais ma thèse s’est passée dans un laboratoire où l’ambiance était très compétitive. Des chercheurs de mon équipe se faisaient des coups bas pour postuler chacun aux mêmes opportunités de recrutement, il se disputaient sans cesse, parfois devant moi en pleine réunion sensée faire avancer mon travail. Moi j’ai toujours eu un idéal dans lequel la recherche était une émulation collective : c’est excitant, de réfléchir à plusieurs, de rebondir sur les pistes des uns des autres, de faire une lecture critique d’article collective. J’avais connu ça un peu dans les stages avant ma thèse, mais je n’ai pas eu ça pendant ma thèse. Sans compter un co-thésard qui défendait des idées racistes et sexistes, qui étaient tolérés par la plupart des autres personnes, et le décalage social (beaucoup des autres étudiants étaient des normaliens, pas issus de la fac, et… il se ressent, le décalage). Au bout de 3 ans et demi, j’ai soutenu, mais j’étais démotivée et éreintée par cette ambiance. Et puis, ça manquait de concret. Alors, j’ai décidé de le suivre chez lui, d’aller prendre l’air, et de voir s’il n’y avait pas de recherches plus intéressantes et concrètes à faire là-bas. J’ai cherché du travail sur les 6 mois avant de finir, et j’ai décroché un job, pas en recherche, mais dans le monde académique, et qui devait commencer 1 mois après ma soutenance. J’ai pris.

On a vendu tous les meubles, on a payé les billets d’avion avec, et on est partis. Il a dit « il faudra deux ans pour que je me lance », j’ai répondu, vu l’expérience de mes parents « ne rêve pas, se lancer, c’est minimum 3 ans, mais tu peux même tabler sur 5 ans ». On a eu beaucoup de mal à s’installer. La vie coutait très cher, et pendant des mois, j’ai eu l’impression de camper. On n’avait aucun soutien familial ; sa famille à lui était pauvre et dans une ville éloignée. Je cotisais en France pour ma retraite et ma sécurité sociale, mais cela prenait la moitié de mon salaire. On dépensait l’argent économisé pour que je rentre en France une fois par an voir ma famille. Je passais mon temps à travailler avec un contrat à 41h/ semaine, je voyageais beaucoup pour le travail, je n’avais pas le temps ni l’espace pour me créer un cercle social. Quand je rentrais, j’avais envie de me poser chez moi. Il n’avait pas de revenus au début, mais je pensais à mes parents, au fait qu’il travaillait pour, et dur. Au fait que quand on travaille, on fini par y arriver. Et au fur et à mesure des années, il a fini par comprendre comment faire. Il a fini par comprendre que s’il ne décrochait jamais de contrats, c’est d’une parce que si t’as pas de trésorerie au départ, personne ne te fait confiance, de deux parce que les passations de marchés n’étaient pas accordées de manière propre.
Il a dû commencer à bosser comme « consultant » local pour des plus gros que lui. Des entreprises françaises et européennes, qui voulaient obtenir ces marchés, mais avaient besoin de quelqu’un pour faire une partie du taf relationnel et de soumission des projets sur place. Et là, il a commencé à observer les pratiques. Y avait des « délits d’initiés » (pire en vrai, des entreprises étaient embauchées en sous-traitance pour écrire le cahier des charges, et ça leur permettait de l’écrire de telle manière qu’elles seraient les seuls à pouvoir remplir les critères, donc les seuls à être aptes à obtenir le marché), y avait des rétro-commissions. Y avait des mecs qui servaient de fusibles quand une fraude était mise à jour. Des « consultants », comme lui. C’était le consultant qui avait prétendument fraudé, pas la grosse entreprise française. J’ai donc découvert la françafrique, la manière dont les grosses entreprises internationales continuent à faire leur jus, en concurrence déloyale totale avec toute entreprise locale qui voudrait se lancer en concurrence. Il a fini par être repéré par un richissime français, gros PDG d’une filiale d’une entreprise française de très gros calibre. Il lui a dit « associe toi à mon fils, il ne fait rien, il fait la fête, il dors toute la journée, il a besoin d’être tiré un peu par un mec qui bosse ». Ils se sont associés, ça faisait un garant financier. Parfois il me disait « Tu sais où il a passé le week-end l’associé ? A Monaco ! Il a fait l’aller-retour en jet… ». J’ai commencé à entrevoir comment vit la haute bourgeoisie. J’ai déchanté. Je ne voulais pas en faire partie moi de ce monde-là, tellement éloigné de mes idéaux à moi. Lui aussi, il a déchanté un peu, mais il ne voulait pas voir son rêve de réussite sociale s’envoler, alors il a commencé à juste moins m’en parler.

En parallèle, on a eu des enfants. Et au bout de 5 ans, j’ai commencé à vouloir revenir vers la recherche. Alors j’ai « soumis des projets » à des philanthropies, et pile à la naissance de mon 2e, j’ai obtenu un financement pour 2 ans, mais qui ne permettait de me rémunérer qu’à mi-temps. Je ne pouvais pas laisser mon autre job, sachant les opportunités à long terme rares. Alors j’ai négocié de passer à mi-temps sur mon ancien job aussi. Et je me suis donc retrouvée avec deux pleins temps… payés chacun à mi-temps. Et deux enfants. Ce que je n’avais pas anticipé, c’est que de son coté, lui aussi, son travail a commencé à s’emballer pile au même moment. Et là où le travail domestique a augmenté pour moi avec les enfants, lui n’a pas « pris sa part » de ce travail là. Non pas parce qu’il considérait que c’était « mon » taf. Non. Parce qu’il fallait qu’il travaille. Parce que c’était ce que je voulais, non, qu’il gagne sa vie ? J’ai pensé que ça passerait, qu’il finirait par pouvoir salarier d’autres personnes, et que ça l’allègerait. C’est ce qu’il disait, en fait. Notre couple commençait à vraiment se déliter. Nous avions tous les deux la tête totalement dans le guidon, entre le travail en surdose, l’isolement familial, et les enfants, il n’y avait plus aucune vie sociale ni aucune vie de couple. Mais je me disais « tous les couples ont des bas ». Et puis, mon projet de recherche arrivant sur la fin, je suis tombée enceinte du petit dernier. Et là, ça a été la descente aux enfers. Plus âgée, en charge de deux petits de 3 et 5 ans, j’étais beaucoup plus fatiguée. Je ne l’avais pas anticipé. J’ai eu un décollement de membrane. J’ai eu un médicament pour régler ce problème, mais ce médicament me faisait somnoler. Je passais prendre les enfants le soir, et je rentrais m’affaler dans le canapé. Ils jouaient, et j’étais incapable de me remettre sur mes deux pieds. Toute énergie avait quitté mon corps. Lui, il arrivait du travail à 21h, et me trouvait comme un zombie. Il faisait à manger aux enfants, qui dormaient donc à 22h ou 23h. Je tentais d’exprimer que ce n’était pas possible, que des enfants ne peuvent pas manger si tard, qu’il devait rentrer plus tôt, que je ne tenais plus. Mais la réponse était invariablement « je dois travailler ! si je ne travaille pas, c’est l’échec ! ».

Il était tendu par son travail, ça le rendait désagréable. Envers moi, parfois envers les enfants. Mon travail à moi s’est mis à se déliter aussi. J’ai dû annuler toutes mes missions. Je n’étais plus capable de rien faire. Je n’étais pas en mesure d’écrire les articles liés à mon projet de recherche qui était fini, alors que les résultats étaient importants pour sauver des vies (oui, on écrit les articles sans être payé, c’est « comme ça » en recherche). Mon médecin m’a prescrit quelques jours d’arrêt par ci par là. Mais je culpabilisais vis-à-vis de mon employeur et de mes collègues, car il n’y avait personne pour me remplacer, et tout le monde devait se taper une surcharge de travail. J’ai eu peur, très peur, de perdre mon travail. Chaque fois que j’essayais de faire comprendre les difficultés, il n’a pas entendu. Il avait la tête dans le guidon. Mais surtout, surtout. Il croyait au Dogme. Le dogme de la méritocratie. Celui qui dit que si tu travailles dur, ta vie sera belle et réussie. Tu auras le graal. Une belle famille, une belle maison, une belle voiture. Pour lui, ce n’était pas possible que ça craque. Car il faisait tout ce que le dogme commandait : travailler dur, très dur. Tout faire pour gagner de l’argent. Et moi je me liquéfiais, physiquement et mentalement, et mon affection pour lui étaient en train de finir de se liquéfier aussi, mais le dogme n’enseigne pas comment le travail peut briser les corps. Comment il brise les vies, les personnes, les couples, les familles. Aux presque 2/3 de ma grossesse, il a fait une hernie-discale monstrueuse, après une sortie professionnelle déraisonnable l’ayant conduit à faire des heures sur des routes en mauvais état (un samedi où j’étais restée, du coup, bien qu’épuisée et déjà bien arrondie, seule avec les enfants). J’étais liquide, il est devenu doublement infect, à cause de la douleur. Ça a achevé de me convaincre : c’était définitivement terminé, lui et moi.
Je suis rentrée finir ma grossesse chez mes parents. C’était prévu, comme pour les deux précédentes. J’ai pu me reposer un peu. J’ai été chouchoutée. Un troisième trimestre de grossesse est difficile, mais celui-ci m’a presque semblé moins dur que le deuxième, tant mon corps avait morflé. Je savais qu’en rentrant, j’allais rompre. Mais il fallait aussi que je me remette au travail, surtout que je n’avais aucun filet social avec mon contrat africain (pas de chômage, pas d’allocations familiales). Notre histoire était plus que terminée, mais je ne pouvais pas partir sans travail. J’ai rompu le lendemain de mon retour : il n’avait pas fallu 48h pour une énième dispute. Il m’a fallu des mois pour me remettre physiquement. J’ai eu d’autres problèmes de santé, j’ai eu un accident de voiture, aussi, à cause de l’épuisement. Encore maintenant, un petit microbe me met au sol, alors que j’ai eu une résistance incroyable toute ma vie. J’ai découvert ce qu’était avoir des limites physiques. J’ai découvert que si je ne me ménageais pas, j’allais juste craquer totalement. Le travail et les grossesses m’ont clairement abimée.
Le racisme à contraint nos décisions. Il n’avait d’avenir que dans son pays, car les discriminations systémiques le réduisaient à des petits boulots en France. Même chez lui, finalement, on ne lui faisait pas confiance, jusqu’à ce qu’il ait un associé riche et blanc (…même fainéant). Nous nous sommes donc retrouvés dans une grande ville, isolés de toute famille, de tout soutien social. Lorsque le travail est devenu trop intense, ce soutien a manqué, et ma condition féminine s’est faîte ressentir : là aussi, j’étais contrainte. Enfants et travail… je ne pouvais pas tout gérer. Quand tu en parles on te dit « ah mais il faut faire des choix dans la vie ! » Et implicitement, mécaniquement, ça s’est mis en place : c’est moi qui devais les faire, les sacrifices, les renoncements. Car lui, il était un homme, et qu’un homme qui ne réussit pas socialement, qui ne nourrit pas sa famille, dans sa tête, c’était un mauvais homme. Alors qu’il me mette dans ce choix impossible ne travaillait pas sa conscience, puisque le dogme disait : si tu travailles dur, c’est ça qui fait de toi un homme bon. C’est ça, qui te vaudra une reconnaissance sociale. C’est (entre autres) ça, le patriarcat : même moderne dans ta tête, tu retombes dans les rôles et les contraintes, car tu veux bien être moderne, mais pas jusqu’au point où ça te décrédibilise socialement. Et la pression était double pour lui, en fait, car il était noir. A ses yeux, il devait réussir deux fois plus, pour la gagner, cette crédibilité. Et puis moi j’étais salariée, soumise à des exigences d’un patron qui ne tient pas compte de la faisabilité, et qui met toujours en avant les exigences des bailleurs. Comme d’autres mettent en avant les exigences des clients. Si le projet tombe (/ si la boîte tombe), on tombe tous. Argument imparable. Qui voudrait perdre son taf ? C’est ainsi que fonctionne ce monde de compétition capitaliste : si tu veux garder ton travail, bosses, et si tu morfles… on comprend bien hein, et oui bon tu as des enfants, c’est dur pour vous les femmes, c’est vrai, c’est vrai, mais désolé, faut quand même qu’il soit fait le travail tu comprends bien. Alors tu morfles encore. De tous les coté, tu morfles. Si j’avais quitté mon travail, on n’aurait plus bouclé le budget. Et je n’aurais plus pu partir au moment où la rupture déjà entamée de toutes manières se serait produite : dépendante, j’aurais été coincée.

Il y a un truc essentiel que tu apprends quand tu subis les oppressions : tous les choix qui s’offrent à toi sont mauvais. Ce sont ces contraintes-là, qui rendent tous les choix mauvais, qui « font système ». Qui font que les oppressions sont systémiques.
La majorité d’entre nous sont à la fois opprimés et oppresseurs
Ne suis-je que victime, qu’opprimée, dans mon histoire? Non, il manque un bout. Le premier bout était déjà assez intime, mais le deuxième est encore un peu plus dur à écrire. Mais je crois qu’on doit tous passer par là, par une introspection de comment on est dominant. Il se trouve que pour la plupart des gens, la manière dont l’exploitation d’autrui leur bénéficie, la manière dont ils bénéficient de privilèges, leur est invisible. En ce qui me concerne, une partie au moins est bien trop visible pour que je l’ignore.

Quels sont mes privilèges ? J’ai suivi mon ex dans son pays, un pays pauvre où les gens sont mal payés. Un premier privilège qui saute à mes yeux, c’est la rapidité avec laquelle j’ai trouvé un boulot pas trop mal payé (je ne suis pas richissime au regard des standards français, hein, mais mieux payée que la plupart des personnes que je côtoie). A l’époque où j’ai trouvé mon taf, je n’avais pas énormément de recul sur mes privilèges, j’en ai plus maintenant, et je sais que le boulot que j’ai pris, c’était un boulot correct en moins pour une personne sur place. C’était facile de me dédouaner : ça permettait à mon ex de rentrer chez lui et de se lancer, il était bénéficiaire… indirect. Et puis, je forme des gens, c’était aussi facile de se dire que je transmettais des connaissances que j’avais eu le privilège d’avoir parce que j’avais étudié dans une université avec plus de moyens financiers et humains, et que du coup les personnes que je formais bénéficiaient aussi… indirectement. C’est comme ça qu’on se dédouane souvent, les opprimés aussi bénéficient de notre privilège… indirectement. Mais bon on voit bien, il aurait fait des petits boulots dans mon pays, je prenais un boulot qui aurait été utile à autrui dans le sien. Pas vraiment de bon choix.

L’autre gros morceau c’est que désormais, je suis monoparent de 3 enfants en bas âge, dans un pays sans filet social toujours, sans périscolaire (or les enfants terminent à 15h), sans relais familial ni amical, avec un contrat où la base temps plein c’est 41h par semaine et sans RTT. Du coup, j’ai une femme noire qui travaille à mon service à plein temps, parce que c’est ça où… ne pas survivre à ma vie. Je suis une femme blanche dont la vie ne tiens que grâce aux services d’une femme noire. Qui travaille autant que moi, mais qui est forcément moins bien payée, puisque payée avec un bout de mon salaire. Là encore c’est facile de se dédouanner : « oui mais sans moi, elle aurait sans doute pas de boulot ! Elle a un boulot grâce à moi. ». Un gros classique, cette réplique. Non, en vrai elle a ce boulot parce que notre organisation sociale ne lui permet pas d’en faire un où elle n’est dominée par personne. Parce qu’elle n’a pas eu accès à des études. Qui préfère faire un boulot dans lequel il doit répondre à des ordres plutôt que d’être totalement autonome? Personne. Et j’ai beau être pas chiante et gentille, ce n’est pas la question : il y a un rapport de domination, et ça va forcément la conduire à prendre sur elle quand elle est fatiguée, ou à avoir peur de faire une connerie, parce qu’au final, c’est à moi que tient son boulot. Si on se disputait, le rapport de force serait inégal. Elle le sait, et je le sais. Et ça suffit à introduire un rapport de domination. Du même ordre que ce qui me conduisait moi à pousser mes limites physiques parce que j’avais peur de perdre mon taf, sans que personne n’ait besoin de me l’ordonner directement. Mais… moi-même, je suis déjà dans un sale état physiquement. Sans elle, je me retrouve à la rue, littéralement. Je n’ai pas de réserve, j’ai besoin de mon salaire, et j’ai besoin d’elle pour travailler et gagner un salaire. Donc là encore, pas vraiment de bon choix.
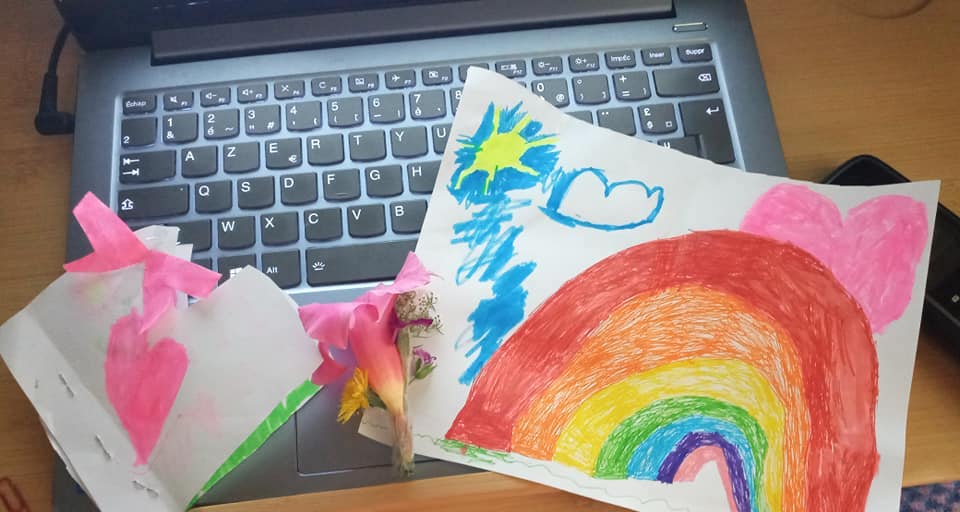
Jamais de bon choix. Tous les choix sont mauvais. Mais le fait que tous les choix sont mauvais ne doit pas nous conduire à refuser d’admettre que les choix qu’on fait sont mauvais, en fait. C’est un truc qui va être assez clef dans le fait d’être de gauche ou de droite : mettre sa culpabilité sous le tapis et mettre en place tout un système pour rationnaliser la manière dont on exploite autrui, ou accepter qu’on fait des mauvais choix, et lutter pour mettre en place un système dans lequel on n’aura plus autant ces contraintes, pour que les générations futures en aient d’autres, des choix.
Les gens de droite nous reprochent souvent notre « incohérence ». Tu défends tel idéal mais regardes, toi-même tu exploites ! Mais la cohérence n’est pas possible dans un monde capitaliste. Il faudrait aller vivre tout nu dans les bois, pour n’exploiter personne. Attention, ça ne veut pas dire qu’il faut faire comme eux et se résoudre à exploiter. Il faut faire les choix les moins pire, a minima, et refuser de se voiler la face sur l’injustice à laquelle on participe. Eux ils font quoi ? Comme je disais plus haut, ils vont construire tout un système de croyances qui va justifier le statut quo et alléger leur conscience. A savoir :
- Si des personnes sont en bas de la pyramide, c’est principalement parce qu’elles ont moins bien travaillé ou moins bien mérité. On appelle ça la croyance en un monde juste. Ce qui est fondamental dans cette croyance, c’est l’idée que ce sont des facteurs qui sont liés à l’individu, à son fonctionnement à lui, donc à son mérite et à sa responsabilité, qui sont sous-jacents à sa situation. Bon on l’a vu dans ma première partie, mais ma vie est assez nette sur ce point : c’est les moments où j’ai le plus travaillé qui sont les moments où j’ai le plus échoué. Oui j’ai toujours travaillé dur (plus que la majorité des gens, ça c’est clair, je n’ai eu que deux années de « vie sociale » avec quelques sorties avec des amis sur 37 ans de vie, je ne connais ni les classiques du cinéma, ni les classiques de la musique, j’ai une culture hyper hétérogène, car tout mon temps… je l’ai « investit » à combler les lacunes que j’avais, et j’ai tout misé dans ce qui m’intéressait le plus, les sciences), mais les moments où j’ai le mieux réussi sont les moments où ce travail, même s’il était intense, était le moins synonyme de souffrance. Parce que les contraintes qui ne dépendaient pas de moi étaient moins forte, j’étais « adaptée » au contexte (je bosse mieux en autonomie, en autodidacte, et à la fac, c’était exactement ce qui était attendu), et donc ce travail pouvait plus facilement payer. Ça me donne une perspective assez intéressante sur la croyance que « quand on veut on peut », cette alternance entre phases d’échecs et de réussites. Depuis cette perspective, c’est faux, le travail est une condition nécessaire pas du tout suffisante pour la réussite. Il faut des conditions favorables en plus. Il faut noter que cette croyance elle est justifiée par tout un tas de sous-croyances. Elles sont nécessaires car c’est un peu évident quand même que les femmes et les non blancs (ou non blanc est ici une construction sociale qui ne se limite pas à la couleur de peau, attention) ne sont pas beaucoup représentés dans les postes qui sont synonymes de « réussite ». Ça se voit tellement ce pattern, que pour garder cette croyance il va en plus falloir croire que femmes et les non blancs sont « moins intelligents, plus fainéants, moins compétents », et autres joyeux stéréotypes qui expliquent pourquoi ces personnes sont pas aussi bien représentées dans ces postes. Ils s’en défendront toujours hein, mais gardez ça en tête : leur croyance en un monde juste ne « tient » que grâce à ces sous-croyances. S’ils croient en un monde juste, ils ont forcément ces croyances sexistes et racistes là aussi, en arrière-plan. Et là s’ils me lisent ils se disent sans doute qu’il y a du déni de ma part, qu’elles sont bien là ces différences, parce que « on voit bien aussi » que certaines femmes seront moins compétentes par exemple… moi ce que je vois c’est un système où elles sont trop contraintes pour même ne serait-ce que réussir à aussi bien se former, et où les femmes qui y parviennent sont en moyenne plus compétentes que les hommes, voir ici, et là.
- Les personnes en bas de la pyramides sont redevables à celles qui sont au-dessus d’elles, de leur « donner » un job. Hé les gens, si les moyens de production (les terres, les outils, les brevets, etc) étaient partagés équitablement, faisaient partie des « ressources communes » (comme genre les routes, payées par tous, au bénéfice de tous) au lieu d’être confisqués par ceux qui sont riches en premier, tout le monde aurait de quoi se nourrir. Et les personnes qui travaillent en dessous sont celles qui « produisent » l’argent qui sert pour les payer, en plus. Le patron, lui il se paye comment ? Avec l’argent que tu lui fais gagner. C’est quand même fou ce renversement des réalités. En vrai, être patron, c’est prélever sa marge sur le travail des autres au prétexte qu’on possède un capital qui permet de dire « preums » et s’accaparer les moyens de production, le capitalisme, rien de plus que ça. Gardez en tête que c’est le travail des gens du bas qui permet aux gens du haut d’avoir un salaire qui est plus important que ce qu’il gagnerait en travaillant tout seul. Et que leur confort de vie ne suivrait jamais s’ils n’avaient pas ce salaire. Ce sont les gens du haut qui sont redevables à ceux du bas. Comme moi je suis redevable de la personne qui travaille chez moi. Notez bien que les hommes dont les femmes travaillent au foyer (leur font à bouffer, repassent leurs chemisent, s’occupent seules de leurs gosses) considèrent aussi qu’elles sont redevables… qu’ils leur achètent de quoi s’habiller, se maquiller, ou sortir ! Elle bosse gratos, dépends de ton bon vouloir pour ses besoins primaires, et tu considères qu’elle doit encore te remercier. L’indécence.
- L’égalité n’existe pas, c’est comme ça. La fatalité est fondamentale dans leur système de croyance. Un système égalitaire ne serait pas possible, il y aura toujours, de manière naturelle, des gens en haut d’une pyramide, et des gens en bas. Et du coup, la seule égalité qu’on doit viser, pour eux, c’est l’égalité des chances. L’égalité dans la probabilité de gravir la pyramide. Mais pas la destruction de la pyramide, qui pour eux est un système « naturel » et incontournable (cf. à nouveau la vidéo de l’Alt Right Play book). C’est très mal connaître l’histoire que d’avoir cette croyance, mais c’est aussi très binaire (on parle de sophisme de la solution parfaite) : à minima, on n’est pas obligés d’avoir une pyramide avec autant d’inégalités !

Il y a un paradoxe, même, qui est que ceux qui ont le plus gravit la pyramide, donc ceux qui sont partis d’en bas, pour arriver en général vers le milieu, sont parfois ceux qui croient le plus dans tout ça. Ils sont à leurs propres yeux la preuve qu’on peut réussir avec du travail. Mais ils ne sont que des exceptions, qui ont eu de la chance ici ou là, bénéficié d’une bonne rencontre, en général. Et ils ne réalisent pas que ceux qui sont au-dessus d’eux ont bien souvent beaucoup moins travaillé qu’eux pour y être. Ils souffrent du biais du survivant. Et bon, c’est facile de se gargariser d’être « celui qui n’est pas comme les autres ». Toi t’es noir mais t’es pas comme les autres. T’es une femme mais t’es pas comme les autres. T’étais pauvre, et tu as tellement travaillé, tu t’en es sorti ! A ceux-là, j’ai envie de dire : n’oubliez pas d’où vous venez.
Le capitalisme nous brise, quoi pour le remplacer ?
Voilà comment le capitalisme, le patriarcat, la suprématie blanche (rappelez-vous : les non blancs sont forcément moins intelligents, c’est nécessaire à la survie de tout leur système de croyance), le validisme aussi (les croyances et comportements envers les personnes ayant des handicaps), et les autres discriminations, peuvent briser les gens. J’étais déjà un peu anti raciste et un peu féministe. Mais je le suis devenu fermement quand j’en ai vécu les effets – avec vivacité – dans ma chair. Et je suis aussi devenue… anticapitaliste. Car maintenant je le sais : si ça a marché pour mes parents, l’ascension sociale, c’est entre autres grâce au soutien familial et aux bonnes rencontres (il y a eu quelques personnes clefs qui ont donné des coups de pouce). Le travail ne fonctionne que si tout autour, l’environnement est propice. C’est facile de croire qu’on a réussi parce qu’on a travaillé dur. Et de louper qu’on a réussi parce qu’on a travaillé dur dans un environnement social qui était favorable à notre réussite. Et puis la génération de mes parents, c’était les 30 glorieuses. Mais c’est fini ça. La planète est à bout de souffle. Il n’y a plus de croissance, et la croissance n’est même pas souhaitable, d’ailleurs. Or sans croissance, pas de plein emploi. Sans plein emploi, il y a mise en compétition des travailleurs. Et s’il y a mise en compétition des travailleurs, il y a rapport de force en faveur du patron, et donc : conditions de travail pourries. Tu prends un travail où le patron impose ses conditions, ou tu es au chômage.

Bref le libéralisme économique contient dans ses fondements même notre exploitation, à nous tous : les femmes qui nous retrouvons à perdre nos emplois parce qu’on peut pas tout gérer, les pauvres qui sont en compétition « pour l’emploi » et « pour la réussite sociale », les non-blancs à qui on ne fait pas confiance ou qu’on emploie pas « parce que les clients leur font pas confiance ». Il y a toujours des « bonnes raisons », qui allègent les consciences. Et je ne parle même pas de ce qui se passe si tu as un handicap (donc tu es improductif), si tu as le malheur d’être trans ou intersexe, ou si tu n’es pas hétéro. Autant de facteurs qui eux aussi peuvent te couper de tout soutien familial, te conduire à être discriminé, ou te mettre en situation d’improductivité. Parce qu’à force de rejet et d’exploitation, aussi, on finit dépressif, et oui, une personne dépressive est improductive.
Il fut un temps où c’étaient les religions qui étaient utilisées pour justifier les inégalités sur la base des croyances qu’elles exhibaient. C’est encore le cas dans certains pays, mais pour la majorité d’entre nous, Français au moins, ce n’est plus tellement les religions qui nous oppriment, ou alors à un degré bien moindre que le capitalisme. Moi j’ai grandi dans une France rurale catholique, j’ai été baptisée, j’ai fait ma communion, ma profession de foi, ma confirmation, j’ai évolué dans des sphères sociales où tout le monde est chrétien, ou on ne parlait même pas de la possibilité d’être athée. En étant athée, et c’était un peu difficile de sortir de ça, d’avouer « je suis athée ». Mais c’était possible, parce que j’ai été à l’école et que je me suis envolée du nid à 18 ans, j’ai pu couper le cordon, m’affranchir et revenir, et dire « je suis athée ». C’était un peu comme un coming out, mais ça a été, finalement. Je sais que ce n’est pas aussi simple pour tout le monde, mais je sais aussi que très peu de ceux qui ont grandit en France… considèrent que la religion est ce qui les opprime le plus.
Ce sont bien la méritocratie, le capitalisme, le sexisme, le racisme, et les autres oppressions identifiées par la (grande méchante, d’après nos dirigeants) « intersectionnalité », qui détruisent nos vies. Je dis ça pour attirer l’attention de tous les « défenseurs de l’universalisme les religions ça doit rester chez soi au nom de l’égalité » : mon ex était musulman et moi athée, mais on ne s’est jamais (jamais !) disputé à cause de la religion. On s’est disputés à cause du travail et de la manière dont ça nous a brisés. Votre lutte n’a aucun sens si elle ne sert pas à nous libérer de nos contraintes, ou si elles alimentent un racisme, notamment islamophobe, qui les renforce, nos contraintes. Votre boussole morale est ancrée dans un espace-temps qui n’existe plus, elle est cassée (et c’est pour ça que c’est principalement des blancs bourgeois qui ont un discours laïcard et pas des prolétaires ou des personnes qui les subissent vraiment, les religions : elles sont désormais surtout, en France, un chiffon rouge pour détourner les regards du système de croyance dominant, celui qui fait tenir le capitalisme).
L’histoire et l’anthropologie nous permettent de savoir que le capitalisme n’a rien de « naturel » ou d’incontournable. D’autres organisations sociales ont existé, d’autres peuvent être inventées. Alors avec ce qu’il nous reste d’énergie, travaillons dur, mais pour donner un autre héritage à nos enfants que celui promis par la méritocratie : une organisation sociale dans laquelle l’accès à une vie décente ne dépend pas des puissants. Ainsi, ils n’auront, eux, pas peur de se retrouver en bas de la pyramide. Car il n’y aura plus de pyramide.
Merci pour ce texte limpide.